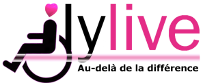IFSI pour travailleurs handicapés : une nouvelle chance ?
2011-10-25 09:34:34.25

Au Centre de Rééducation et d'Insertion Professionnelle de Castelnau-le-Lez (34), il existe un IFSI unique en France. Réservé aux personnes reconnues travailleurs handicapés, il prépare, à l'instar de tous les IFSI, au diplôme d'état infirmier. Une formation comme les autres qui pourtant suscite encore quelques malentendus…
Pour beaucoup, être handicapé et soignant reste incompatible. Et paradoxalement, c'est parmi les professionnels de santé que cette idée est la plus coriace…
Un IFSI (presque) comme les autres
Depuis plus de 35 ans, le Crip-UGECAM Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées forme des étudiants en soins infirmiers reconnus handicapés par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées).
Cette formation rentre dans le dispositif de la réinsertion professionnelle des personnes handicapées (Loi du 11 février 2005).
L'accompagnement pédagogique est conforme au programme national, les élèves font l'objet d'épreuves de sélection, ils effectuent leurs stages et se préparent en 3 ans, comme partout ailleurs. Yannick Ledreux, formateur à l'IFSI, souligne : « Il n'est pas précisé “diplôme d'état d'infirmier handicapé”. Il s'agit du même titre et les étudiants doivent répondre aux mêmes éléments de compétence ».
Seule différence : à l'IFSI de Castelnau, on ne s'arrête pas à la formation. Dans le dispositif, les étudiants bénéficient également d'un accompagnement médico-psycho-social (médecin, infirmière, psychologue, assistante sociale) et d'un “pôle insertion”. Yannick précise : « Nous nous intéressons aux volets humain, individuel et social et au devenir des élèves après leur diplôme ». Une préparatoire santé ciblée sur le projet professionnel et la sélection est également disponible.
Le handicap doit être compatible avec le métier d'infirmier
L'IFSI accueille 51 étudiants (17 par promotion) en reconversion professionnelle ou en formation initiale. Ils ont été orientés vers le métier d'infirmier par la CDAPH (Commission Départementale pour l'Autonomie des Personnes Handicapées), instance de la MDPH, à partir de données médicales, psychologiques et du projet de formation.
Le type de handicap rencontré à l'IFSI peut être très variable : handicap physique, lombalgies, pathologies chroniques, accidents liés au sport, allergies, maladie invalidante… Patrice Thuaud, Directeur de l'IFSI, explique : « La seule condition est que le handicap soit compatible avec toutes les fonctions du métier d'infirmier ».
Il s'agit souvent d'un handicap qui ne leur permet plus d'exercer leur ancien métier. C'est le cas d'Albert, étudiant en 3ème année. Cet ancien chauffeur routier souffre, depuis un accident, de douleurs lombaires qui l'empêchent de travailler en posture assise et de poursuivre son métier. Reconnu travailleur handicapé, il revient alors à un projet de jeunesse : devenir infirmier. Pour lui, « l'accident avait tout arrêté. Cette reconversion est un nouveau départ ».
De son côté, Julie, en 3ème année, n'a pu poursuivre ses études de biologie en raison de tremblements à un bras. Elle souffrait du regard des autres et ne trouvait pas de soutien dans son projet de formation. Elle confie : « Quand je suis partie de la fac, je me disais que je ne ferais plus rien. Aujourd'hui, j'ai retrouvé confiance en moi, j'ai une autre vision de la vie, des gens, du handicap ».
Une représentation à faire évoluer...
Une fois le diplôme en poche, ces étudiants vont pouvoir exercer comme tout le monde. Enfin presque… Sur le terrain, tout n'est pas si simple. Pas du côté des patients comme on pourrait s'y attendre mais plutôt de celui des équipes de soins ! Après un stage de 10 mois dans un CHU, une kinésithérapeute a conseillé à Albert de ne pas faire état de son handicap à l'embauche.
Cela ne surprend pas Patrice Thuaud qui raconte : « Suite à une étude réalisée sur le devenir des diplômés au-delà d'un an, nous nous sommes aperçus que certains ne disent pas à l'embauche qu'ils sont reconnus travailleurs handicapés ». Et Yannick Ledreux confirme : « la représentation du mot handicap dans le secteur de la santé est très négative ».
Il serait la plupart du temps associé à une incompatibilité à exercer la fonction de soignant. D'ailleurs, lorsque Julie s'est présentée au concours d'un IFSI dans une autre ville, la directrice lui a tout simplement expliqué que ce n'était pas la peine qu'elle compte faire ce métier.
Difficile pour ces infirmiers de faire comprendre qu'ils sont simplement handicapés pour exercer leur ancien métier alors que c'est le fondement même du dispositif de reconversion professionnelle. Un chantier d'ampleur s'annonce pour faire évoluer les mentalités…
Article original sur actusoins.com
Retour sur Rencontre-HandicapSuède : vraiment un modèle ?
2011-10-24 08:57:59.343
On entend çà et là que les personnes handicapées sont mieux prises en charge et intégrées dans les pays scandinaves, un point de vue que certains Suédois handicapés ne semblent guère partager...
Le paradis des personnes handicapées se trouverait-il en Scandinavie, ces pays nordiques dans lesquels l'intégration et la citoyenneté seraient la règle ? On lit, on entend fréquemment ce propos, qui prend appui sur l'impact de "l'assistance personnelle", créée en Suède en 1994 : les personnes handicapées ne pouvant effectuer par elles-mêmes les actes de la vie quotidienne disposent de personnels qui assurent l'entretien ménager, la confection des repas, accompagnent et aident lors des sorties et activités, etc. "L'assistance personnelle a été une révolution, relève Maria Johansson, présidente de l'Association pour une société sans handicap (DHR); elle a ouvert la possibilité d'avoir une vie indépendante, fonder une famille, travailler. Au début, cette aide était largement accordée. Aujourd'hui, elle est contingentée. 16.000 personnes en bénéficient sur 300.000 qui sont handicapées motrices au total, dont 100.000 se déplaçant en fauteuil roulant."
Cette assistance est accordée par les communes, avec des inégalités territoriales du fait de la politique définie par les élus locaux, et de restrictions budgétaires qui font que les conditions d'octroi ont été durcies et des contrôles effectués. La formalité est simple mais sans recours : l'assistance personnelle est accordée et évaluée par un travailleur social après entretien avec la personne handicapée, sur certificat médical. Elle peut être partiellement payante : "Le service d'assistance personnelle est gratuit à Stockholm, précise Kaj Nordquist, conseiller municipal et président de la Synskadades Riksförbund (association des malvoyants), mais pas dans toutes les municipalités. Pour les activités ménagères, le service n'est pas gratuit, il y a différents degrés de droits pour en bénéficier. Si on a besoin d'un livre ou d'un magazine qui n'existe pas sur disque, un service d'enregistrement le fait lire et il est envoyé sur un CD".
Kaj Nordquist ajoute que les aveugles ne bénéficient pas de l'assistance personnelle. Et parce que la Suède prohibe la prostitution, Maria Johansson rejette l'idée d'une assistance sexuelle pour les personnes handicapées, tout en mentionnant un substitut possible : "En fait, c'est à l'assistant personnel de définir ce qu'il fait..." L'assistant personnel bénéficie de la gratuité dans les transports et les services, mais la personne qu'il assiste paie plein tarif. Seul cet assistant bénéficie d'une gratuité selon les activités (quelques théâtres et salles de concert, aucun cinéma), mais si une personne handicapée dépendante est accompagnée d'un aidant familial ou amical non salarié, celui-ci paiera plein tarif. Cette règle résulte d'un postulat : l'égalité de droits et de devoirs pour tous les citoyens. De cette égalité découle notamment l'absence de règle de priorité dans les files d'attente, à un guichet par exemple, les personnes handicapées y compris celles qui marchent avec canne ou béquilles, doivent attendre comme les autres : "C'est une demande des associations" confirme Maria Johansson.
La moitié seulement des écoles est accessible, déplore Maria Johansson, alors que l'intégration scolaire est généralisée, ce qui veut dire que la moitié des élèves suédois ne côtoie pas d'enfants handicapés : cela s'en ressent sur le regard que jeunes et adultes portent sur le handicap. Par ailleurs, 50% des personnes handicapées travaillent mais 10% seulement ont un emploi stable. La même règle est appliquée à tous les chômeurs : après 6 mois d'indemnisation, ils ont l'obligation d'accepter un travail à n'importe quel endroit du pays sous peine de perdre l'allocation chômage, sans tenir compte des problèmes de mobilité ni de la difficulté d'obtenir un logement adapté.
La vie indépendante et le statut social des personnes handicapées reposent sur le travail, explique Kaj Nordquist : "Surtout la question de celles qui sont au chômage. Même dans de bonnes conditions d'indemnisation, quelqu'un qui n'a pas de travail ne va pas bien. Beaucoup de personnes handicapées occupent un emploi sous-qualifié, et ça leur fait du mal. D'autres pourraient travailler, alors que notre société vieillit, mais elles restent à la maison et reçoivent de l'aide sociale, c'est bête". Cette aide est pourtant très faible; côté revenu minimum d'existence la Suède est peu généreuse : "Les personnes handicapées reçoivent un subside économique en fonction du degré de leur handicap, environ 2.000 couronnes [220€] par mois exonérées d'impôt à la source", précise Kaj Nordquist. Une somme qui ne permet pas de mener une vie indépendante dans un pays dont les prix sont nettement supérieurs à ceux de la France. "C'est un savant calcul qui laisse un reste à vivre minimum, complète Maria Johannson. La structure très protectrice de cette aide sociale a été revue parce qu'elle n'incitait pas à travailler". Par contre, un employeur peut recevoir 5.000 couronnes (545€) par mois pour financer une assistance à un travailleur handicapé sur son poste de travail. Cette somme est doublée lorsque la personne handicapée est son propre patron, en auto-emploi. L'État finance également les équipements nécessaires à l'adaptation d'un poste de travail, il n'existe pas de quota d'emploi. L'accès à la santé est le même pour tous, l'équivalent de la Sécurité Sociale étant acquis sans cotisation aux personnes qui ne travaillent pas et n'ont pas droit à l'allocation chômage, sans droits particuliers du fait du handicap.
Une accessibilité perfectible. Une agence d'État, Handisam, réalise des études et génère des règles d'accessibilité basées sur les principes de conception universelle ("design for all"), mais elles demeurent d'application facultative. En effet, les aménagements de voirie dépendent des municipalités qui adaptent les règles d'Handisam, ce qui fait que ces aménagements diffèrent d'une ville à l'autre. Handisam n'apporte d'ailleurs pas de conseil en matière de réalisations, chacune des agences d'Etat et des communes se chargeant de la mise en oeuvre. "Ce sont également les municipalités qui gèrent aides techniques et humaines", explique Birgitta Mekibes, chargée d'études chez Handisam. "Elles décident de leur politique en matière de transport et de logement adapté, complète Maria Johansson. La loi n'impose l'accessibilité au cadre bâti que depuis 1996. On construit encore des immeubles inaccessibles, tel le nouveau centre commercial Galerian en banlieue de Stockholm." Par ailleurs, certains conducteurs de bus n'embarquent pas des personnes en fauteuil roulant, invoquant la sécurité ou d'autres raisons; l'accès se faisant par rampe manuelle, les chauffeurs ne quittent pas spontanément leur poste de conduite pour venir la déployer. Et les chiens d'assistance sont parfois refusés dans des commerces ou restaurants.
"L'hiver, c'est terrible, poursuit Maria Johansson. A Stockholm, les rues ne sont pas déneigées au sel mais au gravier, ce qui n'aide pas à circuler en fauteuil roulant. La neige n'est pas enlevée de la partie rampe des traversées piétonnes; et cela empire... Heureusement, les personnes en difficulté peuvent compter sur l'aide des piétons valides si elles la sollicitent. L'inaccessibilité n'étant pas une discrimination au sens légal du terme, les victimes n'ont aucun recours judiciaire et ne peuvent agir que médiatiquement, en alertant la presse et les associations." Cela donne des résultats dans une société de consensus social, mais il y a toujours plus de problèmes à évoquer que d'oreilles attentives.
Pourtant, les associations sont en concertation permanente avec les autorités. Et chaque début juin, depuis 9 ans, ces associations organisent partout dans le pays des marches de protestation pour demander une accessibilité réelle dont les manquements seraient légalement sanctionnés. Saisi de la question, le Parlement a pourtant décidé de ne pas légiférer, le Gouvernement ayant invoqué le coût élevé qu'aurait représenté la nécessaire mise en accessibilité des universités fréquemment installées dans des bâtiments anciens.
Des règles d'accessibilité aux déficients sensoriels sont néanmoins établies pour la télévision, le cinéma, le théâtre, mais sans obligation de mise en oeuvre. Handisam publie ses audits depuis que le gouvernement est devenu conservateur (durant la longue période social-démocrate ces audits ne l'étaient pas).
Kaj Nordquist relativise : "Aujourd'hui, l'accessibilité à l'information est plus répandue, le monde est plus ouvert. Mais en dehors de cela, il n'y a pas grand chose d'adapté pour les aveugles en matière de loisirs, il y a des aides de l'État mais pas plus que dans les années 1970. Cette accessibilité concerne plutôt les autres handicaps."
De fait, si les feux de circulation sont, pour la plupart, sonorisés, les bandes d'éveil de vigilance demeurent rares sur les trottoirs, les distributeurs automatiques de banque n'ont aucune adaptation pour les déficients visuels, et de nombreux "portiers" d'immeubles sont à défilement purement visuel. Quant à Handisam, "elle contrôle mais ne peut obliger", constate Birgitta Mekibes. "Il y a beaucoup de législation, laquelle est de bonne volonté, conclut Kaj Nordquist. On a beaucoup fait, mais beaucoup de personnes handicapées vivent encore à la limite de la société. Elles ne vivent pas, elles n'habitent pas comme les autres. Elles ne meurent pas de faim, mais elles ne sont pas vraiment inclues dans la société."
Article original sur yanous.com
Retour sur Rencontre-HandicapLe fauteuil électrique wHing reçoit le Grand Prix National de l'Ingénierie
2011-10-21 10:27:42.531

SEGULA Technologies et l'Association Française contre les Myopathies (AFM) se réjouissent de l'obtention ce jour du 2e Grand Prix National de l'Ingénierie 2011 (GPNI) récompensant le développement du wHing, premier fauteuil roulant électrique conçu comme un petit véhicule électrique individuel au service des personnes à mobilité réduite. Ce prix décerné au cours des Rencontres de l'Ingénierie par le Ministère du Développement Durable et Syntec-Ingénierie récompense les meilleurs projets de conception français, qui se distinguent par leur complexité et leur caractère innovant.
Pour cette 6e édition, le Grand Prix a été remis à l'équipe d'ingénieurs du groupe SEGULA Technologies qui a travaillé pendant 3 ans au développement du premier fauteuil roulant électrique de conception et de fabrication française. Ces ingénieurs spécialisés dans l'automobile, qui découvraient complètement le secteur des aides techniques aux personnes handicapées, ont abordé la conception du wHing avec une vision large et ouverte des problématiques de mobilité. Ils sont partis des besoins exprimés par les utilisateurs en collaboration avec l'AFM pour imaginer un petit véhicule individuel intégrant en série des fonctionnalités avancées à un coût 40 % inférieurs aux prix constatés sur le marché.
« Lorsque l'on parle du wHing, innovation et inventivité sont indissociables de la demande des personnes handicapées d'accéder à plus de mobilité et d'autonomie. Le fauteuil a été conçu avec pour objectif clair de supprimer le coût restant à la charge de l'utilisateur après déduction du remboursement de la sécurité sociale, de leur mutuelle et des aides disponibles et ce, en complète cohérence avec la politique de l'AFM », explique Bruno Cazé, Chef de Projet chez SEGULA Matra Technologies, le département Automobile & Véhicules Industriels du groupe. « Cela nous a inspiré une conception design-to-cost permettant au rôle social du projet d'être compatible avec une viabilité économique, ce qui représente un gage de durabilité pour les utilisateurs. »
Le développement du wHing a nécessité plus de 60 000 heures de recherche et développement et le dépôt de plusieurs brevets. L'équipe d'ingénieurs récompensée a su apporter au monde des aides techniques ses compétences et savoir-faire issus de l'automobile électrique : « Le fauteuil wHing mobilise les dernières innovations automobiles en matière de simulation numérique, de liaison au sol, de lois de commande, mais aussi de système électrique / électronique et de batteries, avec l'intégration d'une nouvelle technologie de batteries Lithium-ion », précise Bruno Cazé.
L'équipe qui a reçu le Grand Prix National de l'Ingénierie est parvenue à des innovations majeures dans le domaine des fauteuils roulants électriques : des vérins électriques permettent de passer d'une position assise à une position verticale en toute autonomie, grâce à la personnalisation et la mémorisation des différents réglages de l'assise, du dossier et des accoudoirs. De même, l'électronique de commande du véhicule intègre à la fois son pilotage (conduite, réglage de la position) et le contrôle de son environnement par infrarouge (lumières, portes, télévision, …). Le tout est commandé par une interface très attrayante, ergonomique et parfaitement adaptable à toutes les personnes quel que soit leur handicap.
Article original sur Handicapinfos.com
Retour sur Rencontre-HandicapDécès de l'otage handicapée détenue en Somalie
2011-10-20 07:49:27.234

Marie Dedieu, 66 ans, était tombée amoureuse de l'archipel de Lamu au début des années 1990. Elle y coulait des jours heureux depuis.
C'était le combat de trop. Tétraplégique, atteinte d'un cancer en phase de rémission et d'insuffisance cardiaque, Marie Dedieu n'a pas survécu à sa captivité. Hier matin, le ministère des Affaires étrangères a annoncé le décès de la Française de 66 ans enlevée le 1er octobre sur l'île de Manda, au large du Kenya.
Les circonstances et la date précise de sa mort restaient hier soir inconnues, son corps n'ayant pas été restitué par ses ravisseurs, dont on ignore par ailleurs toujours l'identité. Pourtant, « les informations recoupées par nos différents intermédiaires sur place ne laissent aucun doute sur son décès », assurait hier soir une source diplomatique.
Les autorités kényanes avaient établi la présence de la Française dans une zone assez vaste du sud de la Somalie, un territoire contrôlé par les islamistes shebabs. Selon nos informations, les services du renseignement français ont pu établir différents contacts jugés solides dans les jours suivant l'enlèvement. Des médicaments ont été remis à ces intermédiaires, mais rien n'a permis de confirmer qu'ils ont été administrés à la captive. En milieu de semaine dernière, les diplomates auraient demandé une preuve de vie formelle de la Française, préambule à l'ouverture de négociations. Une requête qui serait restée sans réponse, laissant présager le pire.
Installée dans l'archipel de Lamu depuis une quinzaine d'années, Marie Dedieu avait été une personnalité importante du mouvement féministe des années 1970. « A l'époque, elle faisait des études de cinéma, se souvient Antoinette Fouque, fondatrice du MLF (Mouvement de libération des femmes). Elle fréquentait Jean-Paul Léaud et François Truffaut. » Le cinéaste lui offre alors un petit rôle dans « Domicile conjugal » en 1970. L'année suivante, Marie est victime d'un grave accident à bord d'une voiture conduite par un ami. Elle en ressort tétraplégique, mais ne sombre pas pour autant. Elle signe le Manifeste des 343, prend la tête d'une revue féministe éphémère, avant de devenir responsable de la Librairie des Femmes à Paris.
C'est à l'invitation d'un ami que Marie se rend à Lamu, au début des années 1990. Elle tombe amoureuse du lieu. « Cet endroit lui faisait tellement de bien qu'elle s'est remise à marcher avec une canne », souligne Antoinette Fouque. Très appréciée de la population locale, elle était devenue l'une des figures de l'archipel. « C'est un acte de barbarie qui devra faire l'objet des sanctions les plus exemplaires », a prévenu hier François Fillon. Les deux enquêtes ouvertes en France et au Kenya devront notamment déterminer si les ravisseurs ont pu bénéficier de complicités locales.
Article original sur Le Parisien
Retour sur Rencontre-Handicap