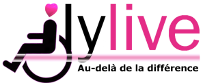Vivre FM - Existe t-il aujourd'hui un marché de la vie affective des personnes handicapées ? - 20ème partie
2014-02-03 16:33:59.437
V. Massias : On a eu plusieurs témoignages de rencontre, notamment d'une personne qui nous avait dit qu'elle avait déménagé au Canada pour rencontrer une personne
qu'elle avait rencontré sur Idylive. Alors, c'est très étrange parce que nous sommes ouverts principalement sur la France, la Belgique et la Suisse, mais qu'on peut se connecter
de l'étranger, on commence un peu à s'ouvrir au Canada.. Ca nous a fait très plaisir de savoir ça. Et puis, moi-même j'ai rencontré quelqu'un sur Idylive donc ça a marché.
B. Cadranel : Et on vit tous les trois en collocation, donc ça marche, on a 10 couples qui se font par mois.
J. Plouseau : Et on peut dire quelqu'un de jeune
B. Cadranel : Oui le tarif : 9,90 euros permet aussi aux jeunes d'avoir accès au site.
Retour sur Rencontre-HandicapVivre FM - Existe t-il aujourd'hui un marché de la vie affective des personnes handicapées ? - 19ème partie
2014-01-30 13:16:11.271
J. Plouseau : Et après on a absolument pas la garantie de rencontrer quelqu'un, c'est pas comme acheter un appareil photo, où si ça casse, on peut se faire rembourser.
P. Duthoit : Sur Meetic, étant donné du nombre de personnes qu'il y a, si vraiment vous ne trouvez personne, c'est que vraiment vous n'avez cherché à rencontrer personne, je pense, car il y a quand même énormément de monde, donc ça me parait difficile. Après, ça reste de l'humain, et on rencontre les personnes qui
nous plaisent ou pas. Y a après, plein de réncontres qui sont possibles : on a des gens je vous l'ai dit tout-à-l'heure, qui ont rencontré des amis, qui se sont fait des amis tout simplement.
J. Plouseau : Mais il y a aussi des mariages
P. Duthoit : Sur les cinq dernières années, 200 000 mariages
J. Plouseau : Et alors sur Idylive, ça coûte combien ?
B. Cadranel : Alors en fait c'est à partir de gratuit, je vais vous expliquer pourquoi. A la base c'est 9.90 euros par mois, Je dis à partir de gratuit parce qu'il y a des personnes qui se désinscrivent, parce que l'accès gratuit ne leur suffit pas. L'accès gratuit, permettant de répondre au Tchat, créer son profil, consulter les profiles, rédiger son annonce personnelle.
Il y a des gens qui se désinscrivent en disant : j'ai pas du tout les moyens. On leur offre le Pass. Et on continuera à offir les Pass dans ces cas là .
J. Plouseau : Grands seigneurs ?
B. Cadranel : Non, je ne dirais pas ça je dirais plutot êtres humains.
Retour sur Rencontre-HandicapVivre FM - Existe t-il aujourd'hui un marché de la vie affective des personnes handicapées ? - 18ème partie
2014-01-27 10:50:32.263
J. Plouseau : Bon c'est le moment où je me transforme en général en Jean-Pierre Pernault, et que je demande : combien ça coûte, de s'incrire sur un site comme celui-ci, sachant que ça s'adresse à des gens qui potentiellement cherchent du travail, peut-être ne vivent uniquement qu'avec l'Allocation Adulte Handicapé ?
Et donc du coup, le moindre coût prend son importance. Par exemple, Meetic, quand on s'inscrit, le forfait de base, c'est combien exactement ?
P. Duthoit : Alors Meetic, vous avez plusieurs offres : 1 mois, 3 mois, 6 mois etc. Ca commence hors promotion etc ou autre, à 19,90 euros par mois pour un mois. Après sur Meetic Affinity, c'est un peu plus cher, parce que exactement il y a un test de compatibilité, il y a des choses comme ça. Après, moi ce que j'ai tendance à dire, c'est 19 euros par mois, pour trouver la personne de sa vie, c'est pas forcément très cher.
J. Plouseau : Après, c'est sans garantie.
P. Duthoit : A non, c'est sans garantie. C'est la même chose que pour les soirées ou les choses comme ça.
J. Plouseau : Donc plutôt que de payer des coûts, aux copains, où on va dépenser 19 euros, pourquoi pas le dépenser en allant sur un site de rencontre ?
P. Duthoit : Non, la question ne se pose pas comme ça, c'est en fonction de chacun, comment est-ce qu'on envisage la suite et ce qu'on est prêt à faire ?
Retour sur Rencontre-Handicap Vivre FM - Existe t-il aujourd'hui un marché de la vie affective des personnes handicapées ? - 17ème partie
2014-01-24 10:44:34.932
B. Cadranel : Oui, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a appellé le site idylive : ça s'écrit IDYLIVE, c'est une contraction des mots idylle et en live. Donc contrairement à nos concurrents, parce qu'on a des concurrents dans le milieu des
rencontres amoureuses dans le secteur du handicap, qui commencent par le prefixe handi : handi-rencontre
J. Plouseau : Donc vous ne vouliez pas stigmatiser les choses
B. Cadranel : Tout-à-fait, on ne voulait pas stigmatiser, mettre une étiquette, et il n'y a pas "handi" dedans.
J. Plouseau : Alors certains diront peut-être après une erreur de positionnement, quand on est un site dédié à la rencontre pour les personnes handicapées, est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait le mot handi dedans
B. Cadranel : A non, ce n'est pas dédié à la rencontre pour les personnes handicapées. Non, nous ne sommes pas d'accord la dessus. C'est dédié aux personnes handicapées ET personnes valides
Retour sur Rencontre-Handicap